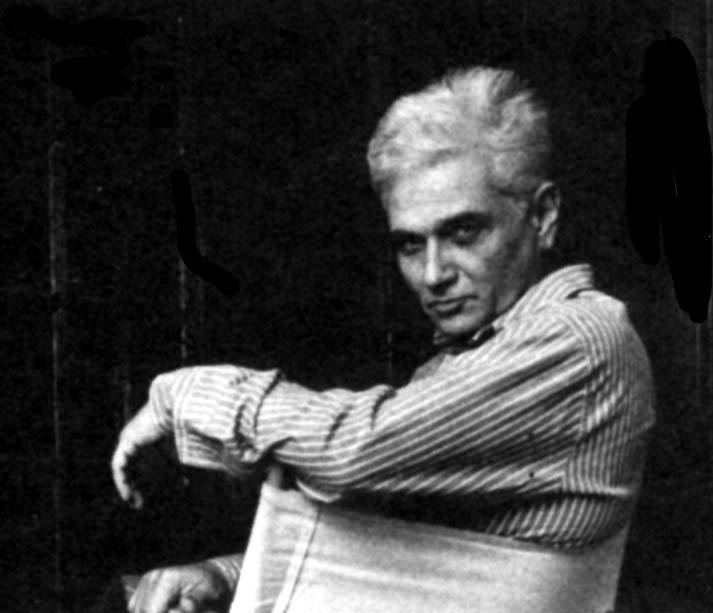Arne Naess (1912 - 2009) : décès du fondateur de la "deep ecology" (par Hicham-Stéphane Afeissa)
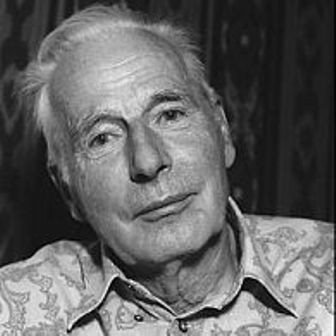
Dans la préface des mélanges offerts à Arne Naess en 1982 à l’occasion de son soixante-dixième anniversaire, Ingemund Gullvag et Jon Wetlesen attiraient l’attention sur ce qui constituait, à leurs yeux, la spécificité de la recherche philosophique qu’Arne Naess aura conduite durant des décennies, tout en justifiant par la même occasion le beau titre – In Sceptical Wonder – donné à leur ouvrage d’hommage collectif :
"Selon le mot bien connu d’Aristote, la philosophie commence avec l’étonnement.
Il semble toutefois que de nombreux philosophes cessent bien vite de s’étonner, et se soucient plus de certaines réponses, qui leur sont particulières, que des questions qui les ont engendrées.
Mais il est d’autres philosophes qui réussissent à maintenir en éveil leur étonnement, à interroger les anciennes réponses et à en poser de nouvelles.
Ceux-là se distinguent par une certaine disposition d’esprit, une inclination au scepticisme, et plus particulièrement au scepticisme de l’école des pyrrhoniens, les zetetaï comme ils aimaient à s’appeler eux-mêmes, c’est-à-dire "ceux qui cherchent" ou encore "ceux qui interrogent"."
L’homme qui est mort ce lundi 12 janvier 2009 à l’âge de quatre-vingt-seize ans était incontestablement de cette race là – très rare – de philosophes.
S’étonnera-t-on d’apprendre que lorsqu’il fonda en 1958 une revue interdisciplinaire de philosophie et de recherches en sciences sociales, qu’il dirigera seul pendant plus de quinze ans en la hissant au rang des meilleures revues scientifiques européennes, il songea d’abord à l’intituler Zetetikos, avant d’opter pour Inquiry ?
Chercheur, Naess l’aura été infatigablement tout au long de sa vie, de la même manière qu’il aura été un célèbre alpiniste ne reculant devant aucune difficulté ni aucune prise de risque .
Né en 1912, le jeune Arne Naess se fera connaître du monde philosophique sans avoir encore rien publié en participant au titre d’auditeur libre aux séminaires du Cercle de Vienne animés par Friedrich Waismann et Moritz Schlick, où le brio de ses interventions lui donnera rapidement la réputation d’être "la nouvelle comète du firmament philosophique" .
Familier de l’empirisme logique pendant plusieurs années, Naess ne reprendra pourtant jamais à son compte les thèses de cette école de pensée.
C’est bien plutôt contre elle qu’il forgera ses premières armes en élaborant une alternative à l’approche atomiste du langage, défendue par le jeune Wittgenstein et Russell, à laquelle il donnera plus tard le nom d’"empirisme sémantique", voulant désigner par là une étude des multiples manières dont le langage peut servir dans des contextes particuliers .
Après avoir soutenu sa thèse de doctorat à Vienne en 1936, Arne Naess reprendra la route de sa Norvège natale où il se verra confier, à l’âge de vingt-sept ans, la chaire de philosophie de l’université d’Oslo.
Il occupera ce poste jusqu’en 1963, devenant ainsi pour longtemps l’unique professeur de philosophie du pays. Comme le note l’un de ses biographes :
"Le milieu philosophique institutionnel en Norvège après la Seconde Guerre mondiale a été, dans une très large mesure, créé et durablement influencé par un homme et un seul : Arne Naess.
Les recherches en sciences sociales qui se sont développées dans ce pays après la guerre lui doivent également beaucoup.
Ses travaux, mais aussi son influence personnelle, ont créé un nouveau climat, favorable aussi bien à la philosophie qu’aux sciences sociales.
L’on peut bien dire que c’est en fait toute une génération d’étudiants qui, d’une manière ou d’une autre, est redevable à Arne Naess, car c’est lui qui a mis en place et défini le système d’examen exigeant de tous les étudiants, quel que soit leur cursus, qu’ils passent des examens en philosophie (en logique et en histoire de la philosophie).
Arne Naess est ainsi à l’origine de toute une "culture académique" dont il est difficile d’évaluer le rayonnement si l’on n’a pas reçu une formation au sein de l’institution universitaire norvégienne."
De ce rayonnement, il est toutefois possible de se faire une idée au regard de la trentaine de livres et des centaines d’articles qu’Arne Naess nous a laissés et qui ont été traduits et publiés en une demi-douzaine de langues .
Spécialiste internationalement reconnu de Spinoza, sur lequel il a beaucoup écrit, il s’est également attelé à la lecture et au commentaire de Kierkegaard, de Wittgenstein, de Carnap, de Heidegger, de Sartre, sans oublier Gandhi dont l’œuvre ne l’a jamais quitté.
Après s’être intéressé à la philosophie des sciences et avoir côtoyé à cette occasion Karl Popper, Arne Naess s’est orienté vers la philosophie du langage, puis vers la logique et la philosophie de la communication, selon un ordre de progression nécessaire dont il ressaisira ultimement la cohérence en y reconnaissant les étapes progressives par lesquelles se constituait sa propre philosophie d’inspiration sceptique.
Mais si l’œuvre de Naess n’avait compté que les travaux universitaires que l’on vient d’évoquer, il est plus que douteux que son auteur ait pu devenir cette véritable figure du génie national que pleurent aujourd’hui les Norvégiens et le monde avec eux .
Le paradoxe veut en effet que le travail auquel Arne Naess devra la plus grande part de sa notoriété internationale ait été intégralement élaboré et publié après la cessation de ses activités universitaires en 1969 et, d’une certaine manière, indépendamment d’elles.
Il faut attendre l’année 1972 pour lire pour la première fois sous sa plume une référence explicite à la doctrine à laquelle son nom restera désormais attaché : l’"écologie profonde" (deep ecology) – entendez : une vaste nébuleuse intellectuelle où se mêlent indistinctement des éléments de spiritualité, des données d’analyse scientifique, des propositions métaphysiques, toute une philosophie de l’environnement que Naess développera patiemment jusqu’à la fin de sa vie, non pas dans la solitude du penseur génial, mais dans la collaboration étroite avec un nombre de plus en plus grand de disciples, d’amis et de collègues qui transformeront la deep ecology en une plateforme de principes d’inspiration expressément pluraliste, et en un mouvement socio-politique d’envergure mondiale .
De cette longue réflexion et de cette expérience commune sortira notamment, en 1989, son livre le mieux connu, Ecology, Community and Life-style, lequel sera suivi quelques années plus tard par son testament philosophique, Life’s Philosophy. Reason and Feeling in a Deeper World .
La deep ecology aura ainsi permis au philosophe d’exercer une influence s’étendant très au-delà des cercles académiques, à tel point que l’on peut estimer sans exagération qu’Arne Naess aura été au XXe siècle l’un des très rares penseurs de l’écologie à avoir réellement modifié la façon dont, partout dans le monde, les hommes se représentent la nature et la place qu’ils y occupent, et par conséquent la façon dont ils doivent se comporter au sein de leur environnement naturel![]()