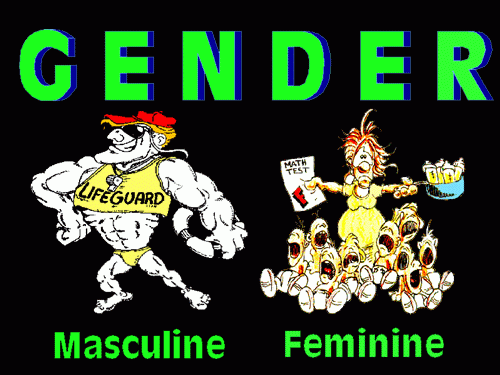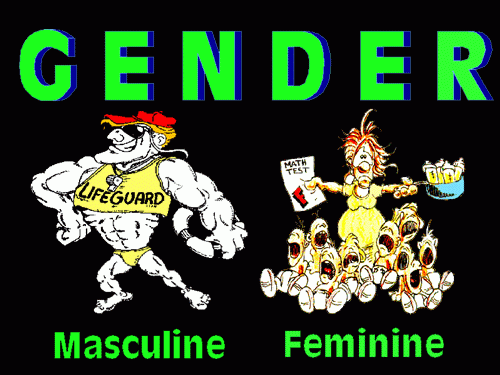
Les contempteurs français des études sur le genre craignent par-dessus tout que les découvertes de ce champ de recherche ne trouvent une traduction à l'école.
C'est un paradoxe.
En effet, si les normes de masculinité et de féminité sont si naturelles, pourquoi craindre à ce point que la différence des sexes ne soit plus systématiquement inculquée aux esprits jeunes et influençables ?
N'est-ce pas de toute façon encore le cas dans les manuels d'école primaire ?
Si la division des rôles sociaux entre hommes et femmes, par exemple dans la famille contemporaine, découle des gènes, des hormones ou d'un décret divin, cet arsenal de représentations par lesquelles on contraint les enfants à leur future place dans la division des sexes ne se révèle-t-il pas bien inutile ?
En réalité, les conservateurs "pour tous" en sont tout à fait conscients : on enseigne déjà le genre aux enfants.
Et si on ne le leur apprenait pas, sans doute ces derniers ne l'inventeraient-ils pas.
La peur que suscite chez les opposants à l'imaginaire "théorie du genre" l'étude des mécanismes de production des normes de comportement et des inégalités entre les sexes ne repose donc pas sur un désaccord empirique : ils savent bien que ces mécanismes existent, puisqu'ils cherchent à les défendre.
Ils préféreraient juste qu'on n'en parle pas et surtout qu'on ne les étudie pas.
Les "antigenre" sont donc les meilleurs défenseurs du "genre", non en tant que champ scientifique, mais en tant que rapport de pouvoir.
Sur le plan des idées, pourtant, leur combat est perdu d'avance, puisqu'il leur faut faire parler du genre pour dire qu'il ne faut pas en parler.
Les approches en termes de genre plongent leurs racines dans les réflexions pionnières de l'anthropologue Margaret Mead dans les années 1930, puis de la philosophe Simone de Beauvoir à la fin des années 1940, bien que ni l'une ni l'autre n'aient eu recours au concept.
C'est dans les années 1960 que le sexologue John Money et le psychanalyste Robert Stoller, qui travaillent respectivement sur l'hermaphrodisme et la transsexualité, théorisent la distinction entre "sexe" et "genre".
Le "sexe" est anatomiquement déterminé, alors que le "genre" désigne l'expérience contingente de soi comme homme ou femme.
Il faut toutefois attendre le début des années 1970 pour que s'opère la jonction entre la distinction sexe/genre et la critique féministe.
La sociologue britannique Ann Oakley se réapproprie cette distinction dans une perspective de remise en question de la hiérarchie hommes/femmes : le sexe renvoie à la partition biologique mâle/femelle, alors que le genre désigne la distinction culturelle entre les rôles, les attributs et les identités des hommes et des femmes.
Le concept de genre devient un nouvel instrument pour révéler les multiples opérations sociales par lesquelles les différences et inégalités entre les sexes sont produites et reproduites.
En France, la distinction sexe/genre est pourtant elle-même remise en cause dès la fin des années 1980.
La sociologue Christine Delphy reconnaît ainsi que l'opposition entre sexe (biologique) et genre (social) a permis de rompre avec l'idée que le genre serait déterminé par le sexe.
Mais cette manière de penser reste empêtrée, selon elle, dans la croyance que le sexe est une évidence naturelle, donnée a priori.
Il n'est pas question de nier, bien évidemment, l'existence matérielle des corps et des attributs anatomiques statistiquement corrélés au groupe des femmes et à celui des hommes. Mais ces différences multiples sont toujours perçues à travers un filtre social qui interprète, classe et transforme.
D'une part, dans le contexte d'une hiérarchisation entre des groupes (le genre), le sexe dit "biologique" fonctionne comme un marqueur social, conférant à cette hiérarchie un fondement qui apparaît comme naturel et antérieur à elle.
D'autre part, le corps lui-même fait l'objet de modifications en fonction des contraintes du genre.
C'est le cas avec les personnes intersexuées dont le sexe anatomique "ambigu" à la naissance est perçu comme une anomalie à réparer.
Comme la biologiste Anne Fausto-Sterling l'a montré, il existe une pluralité de critères de détermination du sexe (chromosomiques, hormonaux et anatomiques) et, dans les cas de naissances intersexuées, ceux-ci ne concordent pas.
Puisqu'il est impossible de s'en remettre à un seul de ces critères, des indicateurs tels que la taille des organes sexuels (un même organe pouvant être associé à un clitoris, donc féminin, ou à un pénis, organe masculin, selon sa taille) ou la capacité reproductive (présence/absence d'un utérus) seront utilisés pour déterminer le sexe de l'individu, par la suite "fabriqué" par des traitements chirurgicaux ou hormonaux souvent lourds et douloureux.
Bien au-delà de ces cas rares, nous sommes tous tenus d'apprendre et de réaliser notre rôle dans l'ordre du genre, tout au long de notre vie, dans les sphères sociales où nous nous inscrivons (famille, école, couple, lieu de travail, etc.).
Or, cette socialisation de genre passe par un travail sur le corps et des modifications physiques (pour les femmes, par exemple, l'épilation de parties du corps et l'usage d'accessoires modelant une silhouette pour qu'elle soit "féminine") qui participent à la reproduction des différences entre les sexes.
Les études décrivant la production sociale des différences de genre sont désormais innombrables.
Pour autant, la conscience individuelle de ces processus ne suffit nullement à mettre à bas un système solidement ancré dans les structures sociales, les corps et les esprits.
En souhaitant en finir avec "le genre", les conservateurs de tout poil rejoignent paradoxalement le discours révolutionnaire du féminisme des années 1970 qui militait pour l'abolition d'une hiérarchie arbitraire entre les sexes.
En parler à l'école serait un bon début.