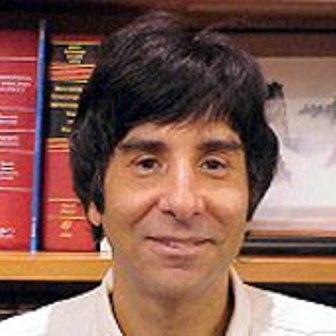LA GRANDE TRIBU DES HOMMES PETITS :
retour sur le meurtre de Sohane Benziane
« Vos femmes sont pour vous un champ de labour : allez à votre champ comme vous le voudrez. » (II, 223)
« Les hommes sont supérieurs aux femmes [...]. Vous réprimanderez celles dont vous avez à craindre la désobéissance ; vous les relèguerez dans des lits à part, vous les battrez. » (IV, 38)
« Abaissez un voile sur leur visage. » (XXXIII, 57)
Le Coran
« Le poil est une trace, un marqueur, un symbole. De notre passé d'homme des cavernes, de notre bestialité, de notre virilité. De la différence des sexes. Il nous rappelle que la virilité va de pair avec la violence, que l'homme est un prédateur sexuel, un conquérant. »
Éric Zemmour
« Ben quoi, ils ont juste cramé une fille. »
Un jeune des cités
« La "proclamation phallique" est un signe de désarroi, d'anxiété et d'incertitude. Alors que toutes les valeurs s'effondrent, jouir est une certitude qui vous reste. [...] Plus l'intelligence se sent impuissante à résoudre et à s'imposer, et plus le coït devient l’ersatz de solution. »
Romain Gary
Le 5 octobre 2002, un jeune homme aux mains calcinées se présentait aux portes de l’hôpital Pitié-Salpêtrière.
Parmi les infirmières de garde présentes ce jour-là, il en fut une, admirablement perspicace, qui ne tarda pas à établir le rapprochement entre ce patient et le criminel dont toute la presse parlait depuis vingt-quatre heures, qui se serait brûlé la veille en immolant - banal plaisir tôt voué au frelatage, le point d’inévitabilité éjaculatoire étant sans cesse différé sous l’action conjuguée de la pornographie et de l’ultraviolence omniprésentes - une jeune fille dans un local à poubelles de Vitry-sur-Seine.
Ayant fourni son signalement à la police, l’infirmière fut accusée de délation par sa hiérarchie et sommée de comparaître devant le Conseil de service pour non respect du secret professionnel.
Le jour même où Sohane Benziane fut brûlée vive, un autre crime, raciste celui-là, avait lieu à Dunkerque, mobilisant cette fois l’ensemble de la classe politique.
Les « délateurs » furent, ici, chaudement félicités. Quant à notre infirmière, elle s’en sortit sans autre dommage, mais cette anecdote reste emblématique du malaise national.
Ainsi la France condamna-t-elle, unanime, Joël Damman, le meurtrier de Mohamed Meghara, fauché, comme Sohane, en pleine jeunesse, à dix-sept ans.
Rien de plus normal, dira-t-on, que cette saine réaction devant l’abject.
L’on était cependant en droit d’attendre, au nom de nos beaux principes républicains, de notre attachement viscéral au Bien, de notre foi inébranlable en notre insurpassable espèce, laquelle, n’en doutons pas, finira par triompher d’elle-même et renaître de ses cendres puisque, selon l’unique formule sacrée ornant les frontispices de nos cités, elle le vaut bien, au moins autant de vert courroux, de fraternelle communion, de franc sursaut civilisateur de la part de ces nobles âmes en révolte, de ces vigilances du cœur armé, de ces chœurs pathétiques si prompts à s’émouvoir, face au meurtrier de Sohane, j’ai nommé Jamal Derrar, alias « Nono », digne fleuron de certaine mâle jeunesse des quartiers dont on attend tout désormais, y compris qu’ils nous consument, qu’ils revirilisent, ensemencent et peuplent la France à venir d’un même puissant et solide coup de reins.
Nono, un homme un vrai, le sauveur de ces messieurs en débandade, le messie zemmourien, que l’on ne saurait élire tout à fait mais sur lequel on louche, quand même, avec envie, dans nos solitudes d’homoncules frustrés, parce que ce sera toujours, bêtement, de pouvoir qu’il s’agira.
Nono, qui savait se faire respecter des femmes forcément inférieures, là-bas, sur les rivages des banlieues proches et lointaines, aussi magnifiques, barbares et fascinantes que les jungles d’émeraude de Kurtz, à la force du vit, de l’allumette et du poing.
Nono, la résurgence d’un très vieux fantasme, un rêve de pierre, de sperme et de sang, un berserk ressuscité poussé à l’ombre des barres grises, un mec qui avait « des couilles » enfin, puisque tout semble se réduire à ça.
Bref, un dur, qui détenait peut-être, allez savoir, intact, le principe de cette virilité fabuleuse toujours-déjà menacée, sans cesse à prouver, à reconduire, à valider en un mouvement perpétuel de surenchère, jusqu’à remettre au goût du jour de vieux usages perdus, par exemple, la condamnation des femmes au bûcher.
Nono, ou l’islam au secours du mâle occidental. Foi de Malek Chebel :
« Je suis toujours surpris par la force de conviction des chrétiens convertis à l’islam. Qu’est-ce qu’ils y trouvent ? Une virilité et une sécurité qu’il n’y a plus dans le christianisme. »
Mais cela, pour qui maîtrise son sujet – et je me targue de le connaître assez bien - n’est hélas qu’évidence.
Et Sohane dans tout cela ?
Le spectacle qu’offrit la France au lendemain du drame est éloquent.
Robert Badinter, d’abord, qui ne trouva rien de mieux que d’opérer devant Alain Duhamel une gradation abjecte des meurtres qui venaient d’être commis (mais il faut dire qu’il est, avec Élisabeth déroutée, à bonne école), jugeant, après avoir évoqué l’assassinat de la jeune fille, « plus important encore » le crime raciste, sans seulement voir, puisque enfin l’on est tenu désormais d’ajouter quelque épithète consacrée, qu’il faut encore mettre celle-ci partout, et qualifier donc le meurtre de Sohane de sexiste, comme le souligna avec force l’avocat général Jean-Paul Content.
Jean-Pierre Raffarin, ensuite, alors Premier ministre, auteur d’un vibrant hommage à la mémoire du jeune Meghara suivi d’une minute de silence à la mosquée de Dunkerque, pendant que Sarkozy réunissait autour de lui les principaux représentants de la communauté musulmane.
C’est en vain que l’on attendit, pour Sohane, pareil déploiement de sympathie.
Le petit monde médiatique enfin, qui ne s’en sortit pas mieux : un journal télévisé de l’époque consacra dix minutes à l’agression du maire de Paris, cinq à Meghara, trente secondes à Benziane.
Certes, et c’est terrible à dire, la valeur d’une femme reste toujours moindre que la valeur d’un homme, y compris dans notre bel Occident démocratique pétri de principes humanisants.
« Ce n’est rien, ce n’est qu’une femme qui se noie », pouvait écrire ainsi La Fontaine, dont l’amende honorable (« ce sexe vaut bien que nous le regrettions, puisqu'il fait notre joie ») fleure plus encore cette misogynie bon teint qui s’épanouit partout.
Les plus grands esprits, lorsqu’ils se mettent à parler des femmes, ou, pis, de la femme, en bien ou en mal d’ailleurs, comme s’il s’agissait de quelque espèce à part, vile ou idéale, à la lisière de l’humanité toujours, où l’une serait peu ou prou la copie conforme de l’autre (il est vrai que Pygmalion fabrique Galatée à la chaîne), excepté quelques différences anatomiques extensivement détaillées, deviennent ces non-esprits creux, vulgaires et radoteurs, ces parfaits clones dénués du plus petit atome d’intelligence, condamnés aux poncifs, aux théorèmes vaseux et aux plaisanteries de caserne.
Pourtant ces matamores pathétiques, qui ont aujourd’hui pour nom Eric Zemmour ou Alain Soral (je ne cite que les plus médiatiques d’entre eux) sont sûrs de remporter, comme hier, tous les suffrages.
Zemmour. Soral.
Les mâles alpha.
Les frères ennemis.
Nos glorieux hommes de demain.
La particule et l’antiparticule élémentaires, dont j’attends avec quelle impatience qu’elles s’autodétruisent lors de ces Ragnarök ultimes que l’Occident féminisé ne leur permet plus de mener, sinon le long des pages ineptes du Figaro Madame, des méandres de leurs cervelles délirantes et des tréfonds abyssaux de la sitosphère.
De fameux agitateurs ma foi, de fiers brasseurs de bière surie, des amateurs de pissat d’âne bâté dont la vertu ne dépasse seulement pas le demi-nanomètre carré.
Des lutteurs de foire dûment récompensés, parions-le, par trois douzaines de houris pour services rendus à la Virilité chancelante.
Comparer le féminisme au totalitarisme, quel flair et quelle bravoure.
Hitler et Staline doivent s’en frotter les mains, à l’heure qu’il est.
Ainsi que tous les Derrar de la terre, et l’on sait combien ils sont nombreux.
N’en doutons plus : le devoir de mémoire est bel et bien passé à la trappe, avec quelques autres principes substantiels, et la reductio ad hitlerum n’est donc plus seulement l’apanage de la gauche boboïsante.
Rien ne semble devoir effrayer ces cuistres passés maîtres dans l'art de la forfaiture et du raccourci médiatique dès qu’ils abordent, la peur au bas-ventre, le dossier femmes, et surtout pas le ridicule, s’égosillant comme coqs en déroute sur leurs tas de fientes androestampillées, forts d’une souveraineté que je qualifierais, puisque je n’ai jamais dédaigné d’employer quelque mot rare, fût-ce pour qualifier l’ordinaire, d’achondroplasique.
C’est contre de telles mauvaises fois, qui partout pullulent, que les meilleures volontés finissent toujours par buter, et qui s’avance les bras chargés de roses doit s’attendre à s’en voir fouetter le visage avec les épines, à rendre compte de chaque bonté exactement, perlée, fourbie par l’âme.
La force, c’est de ne point lâcher les roses et de continuer sa route, mais en ayant désormais, fichée au coin du cœur, la conscience de son échec à créer des liens avec et entre les hommes.
On ne pacifie pas tout un monde en guerre simplement parce que, brave petit soldat, on a décidé un jour de passer outre et de croire à nouveau, de tendre la main à l’ennemi imbécile, après l’avoir combattu, dans un pieux désir de fraternité.
Seulement il est bien vrai que nous sommes seule à désirer la paix, que nous n’avons qu’une seule enfance et que le monde meurt avec elle.
Etrange impression que la mienne, tandis que je rédige ces lignes, celle de me soustraire une seconde fois, de retourner à ma vie fantomatique et comme superposée, au lieu que j’avais désiré renaître par la grâce d’une enfance seconde, luxueuse et illusoire, et de même qu’il n’y a point tout à fait de hasard en ce monde, de même les idées s’enchaînant les unes aux autres finissent-elles par trouver leur cohérence et leur lieu d’élection.
Me voici donc apparemment aussi éloignée de mon sujet que l’austère Sedna du soleil, et cependant je me trouve aussi proche du soleil qu’on peut l’être, puisque la vérité a toujours le tragique éclat du feu.
Aussi vois-je, aggravés encore par la parfaite lucidité du soir, les hommes franchir les arceaux du temps avec le même front débile, et cette odieuse constance, autrement dit cet arrêt au cœur même du mouvement apparent, est bien le signe de quelque damnation irrémédiable.
C’est néanmoins désespérément sereine (et cela confirme la ténuité de ma présence) que je referme cette courte parenthèse incandescente, et que je m’en vais poser une seconde explication à l’odieuse hiérarchie des meurtres à l’œuvre.
Il faut y voir, bien sûr, l’influence pernicieuse de la tribu dominante des petits hommes (mais les petits hommes ne sont-ils pas partout ?) et de leurs innombrables sacculines régnant en maîtres et censeurs sur la parole vraie, condamnée dès lors à l’in-pace ainsi que ceux qui la profèrent, qui adjoignent à force de sentences moralisatrices de relativiser tout crime dont l’auteur est un jeune habitant des cités, reléguant le principe de responsabilité dans quelque obscur cul-de-basse-fosse, quand « être homme, c’est précisément être responsable ».
La France multiculturaliste, pétrie de jésuitisme et de naïveté fausse, est atteinte d’un haut mal : le déni du réel, entraînant à son tour l’euphémisme généralisé.
C’est ainsi qu’un crime devient une incivilité, qu’un homicide volontaire se transmue, au mieux, comme dans l’affaire qui nous occupe, en « actes de torture et de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner », au pire en fait divers.
C’est ainsi que, doucement, l’on donne raison au pire, et qu’après les voitures, on laisse brûler les femmes, sans que cela génère autre chose que de lénitifs rapports dans les médias, lesquels, comme l’AFP, prennent soin de ne pas mentionner la religion des assassins, alors que l’islam et sa haine des femmes sont précisément au cœur de telles affaires.
On ouvre des tribunes aux barbares parce qu’on préfère perdre du terrain que d’affronter la réalité en face.
Et l’on sait où mène ce genre d’aveuglement volontaire : à ce pire, justement, dont personne ne veut, à cette entière récupération du problème par une certaine droite extrême dénuée de toute subtilité.
Tant que nous nous dissimulerons la vérité pour mieux continuer de dormir dans le meilleur des mondes possibles, ceux d’en face en profiteront pour aller toujours plus loin.
De même que nous souffrons du syndrome du colonisateur, les banlieues souffrent du complexe du colonisé.
Ce sont là deux folies parallèles, qui sont la folie même de la France.
On objectera que Derrar, le 8 avril dernier, écopa de vingt-cinq années de réclusion pour son acte abominable, soit sensiblement la même peine que Joël Damman.
Certes, mais outre que ce n’est point là cette perpétuité absolue que pareil crime eût méritée, ce fut bien le vent de la peur qui souffla sur la France au lendemain du drame.
Il parut alors plus prudent, plus stratégique, plus politiquement correct à la classe dirigeante de mettre l’accent sur l’affaire Meghara, puisque enfin, disons-le tout net, le meurtrier avait pour prénom Joël et non Jamal, au risque, conscient, soupesé, accepté, de relativiser l’affaire Benziane, afin d’éviter tout nouvel incident - euphémisme cher à l’époque - dans des banlieues toujours à cran.
Preuve supplémentaire, s’il était besoin, les trois années de patience qu’il fallut à la famille et aux associations féministes pour obtenir du maire (communiste) de Vitry qu’une stèle soit érigée à la mémoire de la victime.
Une stèle qui sera profanée, non pas une, non pas deux, mais plusieurs fois, avec l’odieuse régularité d’une horloge, sans que cela soulève d’indignation particulière.
Le mot d’ordre, ensuite, fut de ne point transformer Derrar en bouc émissaire.
Aussi ce dernier n’a-t-il, à en croire la Cour, jamais eu l’intention d’assassiner Sohane.
Seulement, à moins que ce jeune homme – dont personne ne doutera de la démoniaque candeur - ignorât tout encore des vertus combustibles de l’essence, que peut-on bien vouloir faire avec un briquet allumé près d’une fille préalablement arrosée d’un semblable liquide ?
Parler avec elle ?
Mais peut-être est-ce la nouvelle façon de faire la cour aux femmes, dans les banlieues, auquel cas nous serions, n’en déplaise aux cuistres, en pleine hypervirilisation française.
Chaque homme tue ce qu’il aime, c’est bien connu.
Le mal à l’œuvre, dans cette affaire, était autant dans le local à ordures, dansant son rituel de mort un briquet à la main, que partout autour.
Il était autant en Derrar qu’en Tony Rocca, 23 ans, alias « Pyro » en référence à son amour des engins explosifs, un amour qui lui valut la perte de deux doigts et, détail touchant, d’un testicule.
Rocca, petite frappe au nom tout droit sorti du ghetto italien d’East Harlem, qui maintint la porte du local fermée afin que l’autre puisse tranquillement achever son « truc de ouf » (sic) et qui, contrairement à Derrar, ne baissa nullement la tête lors du procès, mais ne cessa d’adresser des clins d’œil à sa bande.
Le mal était en chacun de ces imbéciles hurlants, acéphales, qui, lors de la reconstitution du meurtre certain 25 mars 2003, et avec le lyrisme qu’on leur connaît, acclamèrent les bourreaux aux cris de « Pyro, Nono, on vous aime », « Nono poto pour toujours », « Nono à jamais », ou encore (légère variante) : « T'inquiète pas, on va pas t'oublier ».
Le mal était enfin du côté de tous ceux qui ne dirent rien.
Détail surréaliste : le sacrifice de Sohane eut lieu cité « Balzac ».
C’est donc là-bas que nous n’oublierons pas que la France fut grande - littérairement parlant - et qu’elle donna au monde des noms illustres dont elle ne fait plus rien, jusqu’à les recycler dans des barres d’immeubles où croît l’engeance violente qui va définitivement la mettre à bas.
Jamal Derrar, comme tous ses frères, grandit dans le mépris de l’autre sexe.
Un mépris savamment distillé par la culture islamique (l’islam n’est-il pas « la religion masculine par excellence », dixit Chebel ?) et, indirectement, la société française, y compris par ceux qui s’érigent en sauveurs des valeurs occidentales tout en pactisant avec l’ennemi sur le dos des femmes : il est vrai que ce mépris-là reste la chose la mieux partagée du monde.
Derrar reçut donc une éducation machiste avalisée par deux Frances pourtant farouchement antagonistes, et ces Frances-là, qui se donnent mutuellement les leçons de morale qu’elles n’appliquent pas elles-mêmes, ont le sang de Sohane sur les mains.
J’attends, pour ma part, l’avènement d’une troisième France, une France éthique qui obéirait enfin à ses principes républicains.
De cet éternel défaut de civilisation Sohane a payé le prix fort, elle qui mourut autant de fois qu’on salit sa mémoire.
Qu’on s’en souvienne, lorsqu’un jour nos pas nous mèneront à Vitry-sur-Seine, et qu’alors nous foulerons le gazon pauvre qui entoure la stèle commémorative, pas très loin de cet anonyme et sinistre bâtiment « H » où mourut la jeune fille.
Qu’on s’en souvienne, lorsque des fleurs cent fois profanées surgira la voix suppliciée, et qu’elle demandera : « Comment ce pays a-t-elle pu laisser pareille chose advenir ? »
Que Zemmour, Soral et tous les petits hommes qui leur ressemblent s’en souviennent, au crépuscule de leur vie, s’ils sont jamais capables du moindre honneur.
Quant à votre serviteur, elle s’en va tranquillement reprendre, après quelque candeur délibérée où elle avait posé ce si léger fardeau à ses pieds, ses vieilles hardes de misanthrope (je n’écris point misandre), abandonnant à la place quelque autre faix plus lourd qu’elle avait cru pouvoir supporter, le temps d’une confiance, parce qu’il faut bien parfois faire halte et boire, réinventer ce monde en le rêvant, bref, croire à la vertu des dialogues transversaux, même s’ils échouent toujours, pour rejoindre son propre chemin d’étoiles et de poussière, des brassées de roses entrenouées aux veines, et les yeux grands ouverts.
Méryl Pinque (2006)
La dernière « sorcière » fut brûlée en terre d’Occident en 1695.
Le Point, 22 septembre 2005.
Élisabeth Badinter commit en 2003 Fausse route, piètre livre tissé d’incohérences volontaires, dénué parfaitement de rigueur analytique, monument de mauvaise foi mâtinée de malveillance à l’égard d’un féminisme qu’elle dénature pour mieux l’invalider.
On se souvient que Delanoë reçut un coup de couteau lors de la très festivissime « Nuit blanche » du 5 au 6 octobre.
Antoine de Saint-Exupéry, Terre des hommes.
« Une jeune femme a été hospitalisée dans un état jugé très sérieux dimanche après avoir été brûlée vive par son ancien ami à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), a rapporté la police lundi. Selon les premiers éléments de l’enquête de la brigade criminelle, la jeune femme, âgée d’une vingtaine d’années, a été aspergée d’essence par le suspect dans une rue non loin de chez elle. Il a mis le feu et pris la fuite se brûlant au bras, selon des témoins. Le suspect, qui a agi par ‘dépit amoureux’, a été identifié et devait être interpellé ‘sans délai’, selon la source. La jeune femme a été admise à l’hôpital dans un état jugé très grave, a-t-on indiqué lundi. » AFP, 14 novembre 2005.
La jeune femme en question est bien sûr Shéhérazade, 18 ans, brûlée vive le 13 novembre 2005 par un Pakistanais dont elle avait refusé les avances.
On admirera avec quel art consommé le journaliste « noie le poisson », transmuant un meurtre sexiste en banale querelle amoureuse.