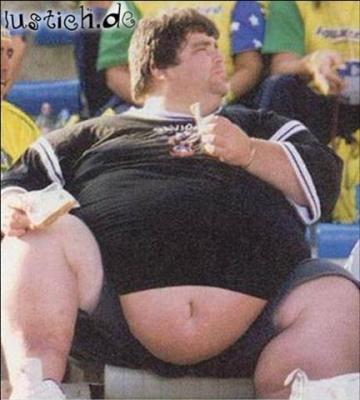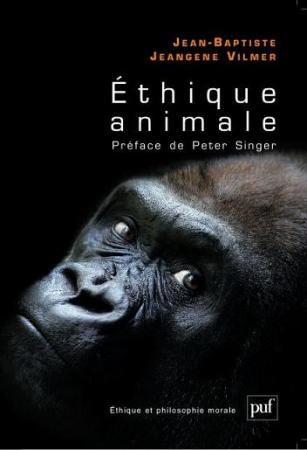Les rencontres « Animal et Société », cycle de négociations destinées à faire évoluer les relations humains/animaux, sont l’occasion de nous entretenir avec Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, philosophe et juriste, spécialiste de l’éthique animale.
Il nous éclairera sur les différentes approches du statut de l’animal, et sur l’état des réflexions actuelles, dont la richesse et la complexité sont relativement méconnues en France.
Ce printemps s’ouvrent à Paris, sous l’égide du ministère de l’Agriculture, les rencontres appelées « Animal et Société ».
Présentées parfois comme le « Grenelle de la protection animale » qui fait suite au « Grenelle de l’environnement » de l’automne dernier, ce cycle de réunions va mêler aussi bien des exploitants agricoles que des ONG de la défense animale, ainsi que des politiques et des scientifiques, afin de réfléchir aux relations humains/animaux et tenter de déboucher sur des avancées concrètes.
Comme l’indique M. Michel Barnier, ministre de l’Agriculture :
« S’appuyant sur des débats d’opinion animés, sur des réflexions scientifiques et éthiques renouvelées, la question du rapport entre l’homme et l’animal a acquis, en une trentaine d’années, une importance sans précédent. »
(http://www.animaletsociete.com)
Le chercheur Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, à la fois philosophe et juriste, a enseigné l’éthique à l’Université de Montréal et vient de publier aux Presses Universitaires de France (PUF) l’ouvrage Ethique animale, qui est une référence en français sur le sujet. Il va répondre à nos questions sur un sujet de société qui est en train d’émerger en France comme une préoccupation importante.
L’utilisation des animaux par les humains recouvre des secteurs d’activités très différents, et les problèmes qui en découlent sont nombreux. Un panorama de la situation est donné dans la deuxième partie de votre livre Ethique animale. Pouvez-vous nous donner quelques exemples qui sont révélateurs de l’ampleur des problèmes ?
Afin de livrer un tour d’horizon assez complet, j’examine six catégories en particulier : les animaux de consommation, de recherche, de divertissement, de compagnie, les animaux sauvages et les animaux de travail. Et, au sein de chaque groupe, un certain nombre de problèmes.
Certains sont bien connus, parce qu’ils sont eux-mêmes spectaculaires ou qu’ils donnent lieu à des réactions spectaculaires de la part des militants : on pense assez spontanément aux abus de l’élevage industriel, à l’expérimentation animale, la corrida, la chasse aux phoques ou aux fourrures de chiens et chats, par exemple.
D’un point de vue purement quantitatif, la question des animaux de consommation devrait être une préoccupation première. L’homme consomme annuellement plus de 53 milliards d’animaux d’élevage, qui représentent plus de 20% de toute la biomasse animale terrestre et, en Occident, 98% de la totalité des animaux avec lesquels nous sommes en interaction.
A titre de comparaison, les animaux tués pour la consommation alimentaire sont 100 fois plus nombreux que la somme de tous les animaux tués dans tous les autres secteurs indiqués ci-dessus. C’est la raison pour laquelle la question du végétarisme est souvent présentée comme une priorité dans la stratégie des défenseurs de la condition animale.
On peut douter, toutefois, de la pertinence d’une approche seulement quantitative, car la cruauté d’une pratique ne se juge pas au nombre de ses victimes. La corrida tue un nombre infinitésimal de taureaux par rapport aux abattoirs, mais elle le fait d’une certaine manière qui non seulement ne vise pas à minimiser la souffrance de l’animal, mais encore s’expose devant un public.
De ce point de vue, par l’exemple qu’elle donne, par le rapport à l’animal qu’elle perpétue, envers et contre les principes et les lois les plus élémentaires en matière de bien-être animal (puisqu’elle est une exception, j’y reviendrai), je considère que cette pratique est autant préjudiciable à la condition animale que les abus de l’élevage industriel.
Si l’on pense, maintenant, aux autres aspects de l’exploitation animale, moins médiatiques peut-être mais tout aussi préoccupants, j’examine par exemple la captivité des animaux sauvages dans les cirques et les zoos, les courses de lévriers, les combats d’animaux, l’alimentation des animaux de compagnie, le phénomène de la viande de brousse, l’impact de la médecine traditionnelle, le sort des poissons - dans les aquariums, lors de la pêche de loisir et dans la pisciculture -, la situation des animaux militaires et les conséquences des exercices militaires sur la faune sauvage, ou encore la bestialité, c’est-à-dire le fait pour un homme d’avoir des relations sexuelles avec un animal.
Bien entendu, la notion de « problème » est elle-même problématique : certains voient des problèmes d’éthique animale là où d’autres ne voient que l’exploitation habituelle des animaux. Tout dépend de la conception que l’on a de l’animal - être vivant sensible, digne de considération morale, ou produit de consommation comme un autre.
De ce point de vue, cette deuxième partie sur les « problèmes » est conditionnée par la première partie consacrée aux « idées », c’est-à-dire aux différentes théories du statut moral de l’animal.
Bien qu’il soit aujourd’hui parfaitement établi scientifiquement que les animaux ont une vie émotionnelle et affective riche, et qu’ils sont autant que l’humain capables de souffrir, ils restent presque toujours considérés comme des êtres de peu d’importance.
Cela se vérifie aussi bien dans la façon dont les humains traitent concrètement les animaux, que dans le langage courant qui traduit un mépris profond de l’animalité (« être un animal », « se conduire comme un animal », etc.). Comment expliquez-vous cet état d’esprit ? A-t-il une justification rationnelle ?
Rationnelle, non, mais il n’en est pas moins puissant, et c’est tout le problème. Le mépris de l’animalité que vous décrivez est la marque de l’anthropocentrisme moral qui domine nos relations avec les animaux - dans le monde occidental en tout cas - depuis deux millénaires. On aurait tort, à mon avis, de concevoir ce comportement comme une exception, un cas particulier.
Cette préférence pour le genre humain, de la part des humains, est dans la stricte continuité d’autres comportements au sein même de l’humanité, comme le racisme et le sexisme, qui cette fois sont unanimement dénoncés, précisément parce qu’ils ont lieu entre humains, c’est-à-dire « entre nous ».
Les discriminations selon l’espèce (spécisme), la race (racisme) ou le sexe (sexisme) ne sont jamais que des manifestations d’une préférence plus fondamentale pour le soi, que certains aiment fonder dans la biologie, et dont l’histoire, faut-il le rappeler, peut aussi être celle de la barbarie.
Lorsque le juge Posner, après de nombreux autres, après Nozick qui invoquait déjà « le principe général selon lequel les membres d’une espèce donnent légitimement plus de poids à leurs semblables », utilise cet argument de la préférence pour les siens afin de justifier l’exploitation animale, Singer a raison de répondre en citant Himmler faisant l’éloge de la préférence nationale et avouant son indifférence quant au sort des « autres races » comme les Russes ou les Tchèques.
Et qui ignore qu’en France aussi, ce genre de raisonnement peut conduire à préférer « sa famille à ses amis, ses amis à ses voisins, ses voisins à des inconnus, des inconnus à ses ennemis » et, en bout de ligne, « les Français, puis ensuite les Européens, enfin les Occidentaux »... ?
Mais dans le cas des animaux, dira-t-on, cette discrimination est bien fondée sur une justification rationnelle, puisqu’ils sont moins intelligents que nous, qu’ils ne disposent pas de ces facultés intellectuelles (la rationalité, l’abstraction, la projection, la compassion, le sens de la justice, etc.) qui garantissent notre différence définitive et qui, de ce fait, nous autorisent à les mépriser et donc à les exploiter comme bon nous semble.
Tout est dans ce double lien de causalité : la supériorité de nos facultés intellectuelles, qui signifie donc l’infériorité des animaux, serait une justification rationnelle au mépris profond de l’animalité et, par voie de conséquence, au peu de cas que nous faisons de leur souffrance.
Or, c’est précisément ici que, depuis Rousseau au moins, un certain nombre de penseurs dénoncent un sophisme : quel est le lien entre les facultés intellectuelles d’un être et la considération que nous lui devons eu égard à sa capacité de souffrir ?
Aucun, sans quoi nous devrions en toute logique avoir autant de considération morale pour les animaux que pour les cas marginaux humains que sont notamment les enfants, les séniles, les comateux, les handicapés mentaux profonds, qui dans certains cas ont moins de capacités intellectuelles que des animaux supérieurs adultes.
C’est le mot fameux de Bentham : « Un cheval ou un chien adulte est un animal incomparablement plus rationnel, et aussi plus causant, qu’un enfant d’un jour, ou d’une semaine, ou même d’un mois. Mais s’ils ne l’étaient pas, qu’est-ce que cela changerait ? La question n’est pas : peuvent-ils raisonner ? ni : peuvent-ils parler ? mais : peuvent-ils souffrir ? »
La tradition utilitariste anglo-saxonne va donc montrer que l’utilisation des critères intellectuels traditionnels pour exclure les animaux de notre champ moral n’est pas rationnelle, comme le rappelle également Sidgwick : « la différence de rationalité entre deux espèces d’êtres sensibles ne permet pas d’établir une distinction éthique fondamentale entre leurs douleurs respectives ».
Cette question n’est pas seulement philosophique, elle a aussi de nombreux aspects sociologiques, des plus passionnants. Ce sont les « stratégies d’exclusion » auxquelles je consacre un chapitre. Il s’agit des stratagèmes, des alibis et de l’ensemble des actions mises en œuvre pour justifier l’exploitation animale et ses abus, tout en modérant la culpabilité des acteurs et des spectateurs.
De ce point de vue, « l’infériorité » des animaux, ou en tout cas ce qui est présenté comme tel, joue un rôle important puisqu’il s’agit d’un mécanisme puissant permettant de se distancier d’eux sur le plan émotionnel. Rappelons également que cette soi-disant certitude est en fait culturellement variable.
James Serpell remarque que seules les cultures ayant domestiqué des animaux défendent leur infériorité. Il en déduit que nous dénigrons les animaux parce que nous les domestiquons. L’infériorité des animaux serait alors « une véritable doctrine politique, propagée pour faciliter l’exploitation animale ».
La « protection animale » est apparue au Royaume-Uni au XIXe siècle, elle fait désormais partie du paysage associatif et sociétal de la France et de beaucoup d’autres pays. Elle n’est pas basée sur des réflexions théoriques de fond sur le statut de l’animal.
Celles-ci sont arrivées beaucoup plus récemment (bien qu’elles aient des racines anciennes) et des réflexions approfondies ont été réalisées, surtout dans le monde anglo-saxon, pour former ce que l’on appelle l’éthique animale. Pouvez-vous nous en donner un aperçu ?
L’éthique animale peut être définie comme l’étude du statut moral des animaux, c’est-à-dire de la responsabilité des hommes à leur égard.
Il s’agit naturellement d’une question millénaire mais le mouvement contemporain, qui s’est rapidement constitué en discipline universitaire donnant lieu à des centaines de formations et des milliers de publications, a son origine dans l’Angleterre des années 70, plus précisément à l’université d’Oxford où se trouvaient réunis, durant ces années, ceux qui sont devenus des acteurs majeurs de l’éthique animale (Ryder, Midgley, Singer, Regan, Clark, Linzey, etc.).
Le retournement qu’opère l’éthique animale anglo-saxonne par rapport à la tradition, c’est-à-dire essentiellement l’anthropocentrisme moral, consiste précisément à affirmer la pertinence de la souffrance comme critère de considération morale.
Ceux qui considèrent la capacité de souffrir, conscience incluse, comme un critère suffisant de considération morale sont généralement des utilitaristes qui raisonnent en termes d’intérêts et qui cherchent à maximiser le bien-être animal (animal welfare) en minimisant la souffrance.
La figure la plus connue de ce courant est bien entendu Peter Singer : « c’est le critère de la sensibilité (...) qui fournit la seule limite défendable à la préoccupation pour les intérêts des autres ».
Ceux qui, au contraire, considèrent que la capacité de souffrir n’est pas un critère suffisant de considération morale et ajoutent d’autres exigences sont généralement des déontologistes qui raisonnent en termes de droits et qui attribuent des droits moraux et/ou légaux aux animaux (animal rights).
Pour Regan, par exemple, le critère de considération morale n’est pas la seule capacité de souffrir, mais la valeur inhérente d’individus qui sont sujets-d’une-vie (subject-of-a-life) - notion dont la définition est relativement étroite, qui ne concerne dans les faits que les mammifères âgés d’un an et plus, en laissant de côté la question de savoir ce qu’il en est des animaux moins évolués.
Pour Wise, également, la capacité de souffrir n’est pas un critère suffisant de considération morale : il lui ajoute l’exigence d’être titulaire d’une « autonomie pratique », c’est-à-dire la capacité de partager certaines tâches cognitives avec les humains (par exemple réussir le test du miroir, qui ferait la preuve d’une conscience de soi).
Définition encore plus étroite, qui ne laisse passer que les humains, certains grands singes (chimpanzés, bonobos, orangs-outans, gorilles), les dauphins et les éléphants.
Peut-on dire que c’est cette commune capacité de souffrir entre les hommes et les animaux qui est à la base de l’éthique animale contemporaine ?
Oui. Les animaux, au moins certains d’entre eux (laissons de côté la question des cas-limites), partagent donc avec les humains la capacité de souffrir. Reste que cette communauté n’implique pas une identité entre les souffrances respectives des uns et des autres, ni même d’ailleurs au sein de chacun de ces groupes.
On peut noter deux différences essentielles. La connaissance humaine, d’une part, qui permet notamment de se représenter la souffrance, peut elle-même être source de souffrance, ce qui double la charge : le condamné à mort souffre de savoir qu’il va mourir dans six mois, tandis que le bœuf l’ignore.
L’ignorance animale, d’autre part, peut également être source de souffrance, puisque l’animal sauvage, par exemple et contrairement à l’homme, ne peut pas distinguer entre une tentative de le capturer pour le détenir et une tentative de le tuer.
Ceci étant dit, ce qui intéresse l’éthique animale au-delà de ces différences est ce que partagent les hommes et les animaux et, surtout, ce que cette commune capacité de souffrir implique pour les premiers relativement aux seconds.
Pourriez-vous développer plus particulièrement la théorie de Peter Singer, professeur de bioéthique à Princeton University, qui a signé la préface de votre livre Ethique animale ?
De cette commune capacité de souffrir, Singer déduit qu’ « il est impossible de justifier moralement le fait de considérer la douleur (ou le plaisir) que ressentent les animaux comme moins importante que la même quantité de douleur (ou de plaisir) ressentie par un être humain ».
Cette commune capacité de souffrir implique donc une égalité de considération. De là, il est important d’éviter deux confusions.
D’abord, l’égalité de considération que prône Singer n’est pas l’égalité de traitement. Ce sont les intérêts de chaque être qui sont pris en compte, et avoir une égale considération pour des individus ayant des intérêts différents peut évidemment conduire à un traitement différent :
« La préoccupation pour le bien-être des enfants qui grandissent aux Etats-Unis peut exiger que nous leur apprenions à lire ; la préoccupation pour le bien-être des cochons peut ne rien impliquer d’autre que de les laisser en compagnie d’autres cochons dans un endroit où il y a une nourriture suffisante et de l’espace pour courir librement. »
Ensuite, l’égalité de considération n’est pas l’égalité des vies. C’est ici qu’apparaissent les limites du critère de la souffrance. L’égalité de considération ne vaut que lorsqu’il s’agit de la souffrance, et non de la vie des êtres en question.
Car, en matière de souffrance, le fait que l’homme soit par ailleurs plus intelligent, plus raisonnable, plus libre si l’on veut que l’animal n’a aucun impact sur leur intérêt commun à ne pas souffrir (tant que les capacités cognitives humaines n’augmentent pas le degré de souffrance).
Par contre, cela a un impact sur leur intérêt à vivre, comme le montre l’exemple suivant. Si nous avions le choix entre sauver la vie d’un humain normal et celle d’un humain handicapé mental, nous choisirions probablement de sauver la vie de l’humain normal (ce faisant, on présuppose que sa vie vaut plus la peine d’être vécue que celle de l’autre).
Mais si nous avions le choix entre faire cesser la douleur soit chez l’un soit chez l’autre, il serait beaucoup plus difficile de se décider (ce faisant, on présuppose qu’ils ont un intérêt égal à ne pas souffrir). Pourquoi ?
Car on estime que tuer un être rationnel, capable de penser abstraitement et d’élaborer des projets revient à lui ôter davantage que la vie, à le priver de l’accomplissement de ses efforts.
Singer conclut donc que « cela signifiera en général que s’il nous faut choisir entre la vie d’un être humain et celle d’un autre animal nous devons sauver celle de l’humain ; mais il peut y avoir des cas particuliers où l’inverse sera vrai, quand l’être humain en question ne possède pas les capacités d’un humain normal ».
Bien entendu, un certain nombre d’auteurs ne sont pas d’accord avec cette position, qui n’accorde aucune valeur inhérente à la vie en elle-même. Tous les déontologistes qui défendent le caractère sacré de la vie, ceux-là mêmes qui s’opposent dans d’autres domaines de la bioéthique à l’avortement ou à l’euthanasie, dénoncent le manque de profondeur et les dangers de l’utilitarisme.
Comment la France s’est-elle inscrite dans cette démarche de réflexions et de positionnements sur la question animale ?
Elle ne s’est pas vraiment « inscrite » dans le sens où la plupart des auteurs français ignorent le débat anglo-saxon.
Singer dans sa préface rappelle que Animal Liberation, qui s’est vendu à plus de 500 000 exemplaires, a été traduit en italien, espagnol, allemand, hollandais, suédois, finnois et japonais avant de l’être en français, presque vingt ans après sa parution.
Son livre, qui aujourd’hui encore reste le seul ouvrage majeur d’éthique animale anglo-saxonne accessible aux francophones, est épuisé depuis longtemps et aucune action n’est entreprise pour le rééditer.
Enrique Utria, doctorant en philosophie, a récemment achevé la traduction de The Case for Animal Rights (1983) de Regan, une autre référence incontournable en éthique animale. Il a visiblement beaucoup de mal à trouver un éditeur.
Tant que les ouvrages anglo-saxons ne seront pas traduits et publiés en français, et tant que les penseurs français ne feront pas l’effort de lire l’anglais, la France ne pourra pas « s’inscrire » dans cette discipline.
Coupée du développement de l’éthique animale anglo-saxonne, la France développe sa propre approche, plus fidèle à sa tradition, qui ne s’inscrit pas dans l’éthique à proprement parler mais plutôt dans la philosophie classique ou première, au sens d’ontologie.
Il ne faut donc pas confondre l’éthique animale, qui est l’étude de la responsabilité morale des hommes à l’égard des animaux, et la philosophie de l’animalité (Animal Philosophy), qui examine la manière dont la tradition philosophique considère l’animal (s’il pense, s’il raisonne, en quoi consiste son essence, son être-au-monde, ce qui le distingue de l’humain), dans une perspective souvent historique, des Grecs à nos jours, mais qui a tendance depuis quelques années à privilégier certains courants (existentialisme, phénoménologie, herméneutique).
La contribution française se fait remarquer à un niveau très théorique, où l’on examine le « devenir-animal » de Deleuze et Guattari pendant que Derrida et Nancy discutent l’humanisme de Heidegger et Lévinas.
Cette branche distincte, dans laquelle s’inscrivent les ouvrages récents de Florence Burgat et Elisabeth de Fontenay, est passionnante mais ne relève pas de l’éthique au sens relativement appliqué où nous l’entendons ici.
Si l’éthique animale existe malgré tout en France, c’est essentiellement grâce à des organisations, et à deux d’entre elles en particulier : la Fondation Ligue Française des Droits de l’Animal (LFDA) et les Cahiers antispécistes, auxquelles je consacre une section. La distinction entre ces deux familles est assez claire.
D’un côté, la LFDA défend un welfarisme modéré qui ne remet pas en cause l’exploitation animale, en particulier l’alimentation carnée, ni le primat de l’homme.
De l’autre, les Cahiers défendent un abolitionnisme inclusif, c’est-à-dire qu’il intègre un welfarisme non spéciste, qui remet en cause l’exploitation animale et défend le végétalisme.
Autrement dit, pour reprendre la ligne de séparation tracée par David Olivier dans le tout premier numéro de la revue, la LFDA relève de la « défense animale », tandis que les Cahiers prônent la « libération animale ».
Par ailleurs, ils offrent depuis longtemps sur leur site internet un grand nombre d’articles et d’extraits d’ouvrages anglo-saxons qui donnent au lecteur francophone un aperçu sérieux du débat anglophone.
Il y a, pour finir, une troisième catégorie d’auteurs français, qui s’intéressent à l’éthique animale pour s’y opposer assez frontalement, dénonçant volontiers « l’extrémisme anglo-saxon », caricaturant le plus souvent sans les avoir lus les penseurs d’outre-Atlantique, réduisant leur combat à de la sensiblerie, pour les décrédibiliser, et rappelant sans cesse combien l’amour des animaux peut impliquer « la haine des hommes ».
Ce sont les humanistes spécistes français, auxquels je consacre également une section (Ferry, Chanteur, Ariès).
Il y a donc un décalage marqué entre les pays anglo-saxons et la France, celle-ci ayant visiblement des difficultés à faire émerger la question animale comme un sujet digne de considération.
Souvent la question du traitement des animaux passe pour un problème sans grand intérêt. Elle est parfois classée comme sous-catégorie de l’écologie, ce qui n’est pourtant pas le cas.
Quelles sont les raisons de cette spécificité française à l’égard de la question animale ?
J’en vois au moins trois types.
Premièrement, des raisons philosophiques, en premier lieu desquelles se trouve l’influence de l’humanisme, qui met l’homme au centre de l’univers, lui subordonne l’environnement (c’est le fameux projet cartésien de « se rendre comme maître et possesseur de la nature ») et se convainc qu’augmenter la considération pour l’animal menacerait le piédestal humain, comme si l’un et l’autre étaient dans des vases communicants, comme si l’on ne pouvait pas travailler à améliorer la situation des deux, dont l’exploitation est d’ailleurs plus imbriquée, voire commune, qu’on ne croit.
Il y a également l’ethnocentrisme, cette imperméabilité dont je parlais tout à l’heure, qui fait qu’on s’intéresse assez peu aux autres traditions (anglo-saxonnes, mais aussi orientales) qui sont susceptibles de remettre en cause la hiérarchie sécurisante dans laquelle nous avons placé l’homme et l’animal.
L’exception française est également causée par la manière dont nous concevons la philosophie, souvent confondue avec son histoire comme en témoignent les auteurs français qui n’abordent des questions éthiques pourtant très contemporaines qu’à travers un catalogue d’auteurs illustres, et la dignité du travail intellectuel en général, puisqu’on a tendance, en France, à faire l’éloge de l’abstraction et à mépriser les problèmes trop concrets, à privilégier la forme sur la matière, et donc à placer les questions d’éthique appliquée, dont fait partie l’éthique animale, loin derrière les intrigues autrement plus nobles de la métaphysique.
Deuxièmement, des raisons culturelles. Singer, dans sa préface, insiste sur l’importance de la tradition gastronomique française. Je plaisante également en disant que les Anglais ont sans doute moins à perdre à devenir végétariens. Ce qui est à la fois faux (parce qu’on mange très bien en Angleterre) et vrai (puisque les Anglais ne font pas de leur cuisine l’un des aspects fondamentaux de leur identité).
Il y a également nos exceptions culturelles. Ce sont les exemples bien connus de la corrida, protégée au même titre que les combats de coqs par l’alinéa 7 de l’article 521-1 du Code pénal, comme une exception valable aux lois existantes sur le bien-être animal, lorsqu’une « tradition locale ininterrompue » pourra être invoquée, et du foie gras, qui depuis l’automne 2005 fait partie du « patrimoine culturel et gastronomique protégé en France ».
Le livre montre à la fois comment les pratiques elles-mêmes sont problématiques et pourquoi le raisonnement qui permet de les protéger est fallacieux, notamment parce qu’il se fonde sur l’appel à la tradition, un sophisme connu depuis deux millénaires sous le nom d’argumentum ad antiquitam : ce n’est pas parce qu’une pratique existe depuis longtemps qu’elle est juste.
Troisièmement, des raisons politiques. La France, qui a la réputation d’être la lanterne rouge de l’Europe en matière de protection animale, ne doit pas cette situation à l’opinion publique qui, si l’on en croit les sondages, est plutôt soucieuse du bien-être animal, mais plutôt à l’influence des groupes de pression.
Deux des volets principaux de l’éthique animale appliquée concernent l’élevage et la chasse. Or, la France, premier producteur mondial de foie gras et troisième de volailles, est un pays d’éleveurs et ses chasseurs sont les seuls en Europe à dépasser la barre du million. Ils sont d’ailleurs très fortement – et non proportionnellement – représentés à l’Assemblée nationale.
Vous avez enseigné l’éthique animale à l’université de Montréal, comment cela s’est-il passé ? Des enseignements analogues sont-ils dispensés dans des universités, écoles ou instituts en France ?
J’étais chargé de cours au département de philosophie de l’université de Montréal de 2004 à 2007. On m’a proposé un cours d’éthique à la faculté de médecine vétérinaire, particulièrement délicat sur le plan pédagogique puisque les apprentis vétérinaires étaient connus pour être rétifs aux spéculations philosophiques.
Dans ce genre de situation, lorsque l’enseignant se trouve face à un public étranger à sa discipline, il est important que chacune des parties fasse un pas vers l’autre afin que la rencontre puisse se faire sur un terrain commun.
J’ai donc limité mon enseignement aux relations entre les hommes et les animaux, dans une perspective assez pratique, qui durant deux ans a pu donner lieu à un véritable cours d’éthique animale au sens où on l’entend dans le monde anglo-saxon.
Les étudiants canadiens sont assez réceptifs à cette discipline qui, culturellement, ne leur est pas étrangère. Nombreux sont les jeunes déjà bien informés, puisqu’ils lisent l’anglais et ont un accès aisé à la littérature sur le sujet, qui a également pu être abordée dans certains cours du secondaire et du Cégep (lycée).
Les végétariens ne sont pas rares. Les médias n’hésitent pas à faire une place à l’éthique animale quand l’actualité l’exige. Bien entendu, certains débats sont plus compliqués au Canada qu’ailleurs, la chasse aux phoques par exemple, et des étudiants en médecine vétérinaire habitués à manipuler quotidiennement de nombreux animaux peuvent parfois manquer de recul sur leur propre pratique et développer des tendances mécanistes.
C’est pourquoi il me semble important que l’enseignement d’éthique vienne de l’extérieur de l’école vétérinaire, afin d’ouvrir les étudiants aux sciences humaines et sociales et compléter leur formation, en évitant le repli sur soi et la réflexion en vase clos.
En France, il y a généralement des enseignements d’éthique dans les écoles vétérinaires, mais ils sont beaucoup plus spécifiques, souvent limités au strict nécessaire, c’est-à-dire aux seules interactions que le vétérinaire est susceptible d’avoir avec des animaux (de laboratoire, de compagnie, parfois sauvages).
Il s’agit davantage d’éthique vétérinaire que d’éthique animale. On cherche certainement à améliorer le bien-être animal et la pratique du professionnel, mais je serais surpris qu’on discute beaucoup de l’abolitionnisme, des droits des animaux, ou qu’on puisse remettre en cause l’expérimentation animale. Or, l’éthique animale, c’est cela aussi.
Quant aux autres disciplines, notamment la philosophie et le droit, il n’y a quasiment aucun enseignement dans les universités, écoles ou instituts en France. Quelques personnes, à l’échelle individuelle, parviennent à aborder ces questions lors de leurs séminaires, par exemple Catherine Larrère à Paris-I ou Florence Burgat à l’EHESS.
Mais il n’existe pour l’instant aucun cours d’éthique animale en tant que tel, et l’écrasante majorité des étudiants français ignorent tout de cet important domaine qui donne lieu, outre-Atlantique, à des centaines de formations universitaires et à des cours distincts dans près de la moitié des facultés de droit, par exemple.
On peut donc souhaiter que les débats, réflexions, études et enseignements se développent autour du sujet de l’éthique animale dont la complexité et la richesse sont parfois sous-estimées. M. Jeangène Vilmer, nous vous remercions d’avoir répondu à nos questions.
_________
Interview réalisée par Franck Michel
Maître de conférences à l’université Paul Cézanne (Aix-en-Provence). Thèmes qui me tiennent à coeur : statut de l’animal, droits des animaux, liberté d’expression dans le monde, responsabilité morale dans les choix de consommation : alimentation carnée, commerce éthique et équitable.
http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=39564