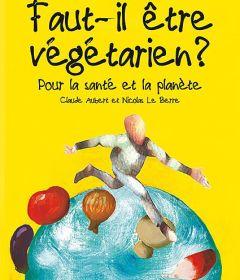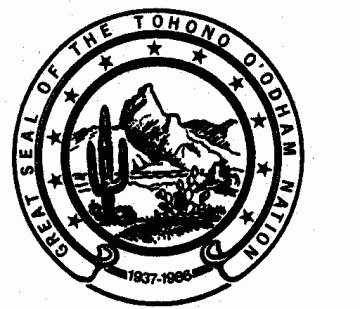Que deviennent les invendus de nos supermarchés ?
CLICANOO.COM | Publié le 9 mai 2008
Chaque année, les grandes surfaces de l’île se retrouvent avec plusieurs centaines de tonnes de produits invendus. Qu’ils soient alimentaires ou non, comment et pourquoi sont-ils quotidiennement retirés des rayons ? Que deviennent-ils par la suite ?
Enquête derrière les étals garnis de la grande distribution.
Mercredi, 13h52. Un rapide coup d’œil à droite et à gauche et hop ! Ce petit gourmand d’environ 7 ans vient d’engloutir en un quart de seconde un savoureux biscuit au chocolat qui, visiblement, lui faisait de l’œil. Consciencieux, il prend soin de remettre le paquet entamé bien à sa place au premier étage du rayon biscuits d’une grande surface. Ni vu, ni connu…
Ce geste n’est pas un cas isolé. “Cela arrive très fréquemment. Malheureusement, tous les paquets qui sont entamés, juste ouverts ou éventrés, ne sont plus vendables. On en retire tous les jours des rayons”, explique le manager du département “Produits de Grande Consommation (PGC) et frais industriel” d’un supermarché dionysien.
Avec les dates limites de consommation (DLC) qui arrivent à échéance, les retards de livraisons ou encore les intempéries, les packagings abîmés figurent parmi les facteurs mettant le plus souvent au rebut quantité de produits.
D’après Carole Bachot, commerciale à la Star, “une très grande surface comme Jumbo Score, par exemple, peut se retrouver à elle seule avec plusieurs centaines de tonnes d’invendus par an”.
Le directeur par intérim d’un supermarché de superficie équivalente affirme que sur leur chiffre d’affaires annuel, “cela représente au moins un million d’euros de perte, uniquement pour les produits frais, avec un pic en période de fête”.
Une masse de rejets dont la majeure partie va tout droit… à la poubelle. “Chaque mois, par département (ndlr : PGC, produits frais, textile…), on jette l’équivalent d’une Mercedes”, poursuit notre manager, qui souhaite garde l’anonymat.
Pour tenter d’enrayer le phénomène, les entreprises de grande distribution ont mis en place différentes stratégies. “Lorsque nous estimons qu’un produit non alimentaire n’est plus vendable pour diverses raisons, nous l’isolons en réserve puis nous le ressortons en période de soldes”, confie un chef de rayon.
Quant aux hard discounters, ils ne sont pas en reste. Selon Eric Dany, superviseur des magasins Dia, pour qu’une grande partie des produits frais puisse être écoulée, l’une des solutions est de faire jouer les prix :
“Nous les baissons à un mois, puis à quinze jours de la date limite de consommation (DLC). Il nous arrive aussi de faire -50% sur un produit qui périme le lendemain”.
Afin de réduire leur budget “pertes”, les grandes surfaces procèdent également à une vérification des palettes de produits fraîchement livrés. Toutes les boîtes cabossées, percées ou encore écrasées sont immédiatement retournées au fournisseur avant même d’être mises en rayon. Celles-ci seront remboursées par la centrale d’achat, ou ne seront tout simplement pas facturées au magasin.
Mais il arrive que, de temps en temps, quelques-unes passent entre les mailles du filet et soient disposées dans les rayons. En ce qui concerne les sacs de riz, de café ou de sucre n’ayant pas trouvé acquéreur, ce sont les fabricants eux-mêmes qui récupèrent leurs propres produits en vue d’une “revalorisation”.
Malgré cela, tout le reste, même si c’est encore utilisable, finit à la poubelle : paquets de couches ouverts intentionnellement par des clients afin de vérifier si c’est la bonne taille, matériel hi-fi comportant de fines rayures, vêtements…
Pour ce faire, les grandes surfaces louent des bennes et des compacteurs d’ordures à des sociétés spécialisées. Elles procèdent dans un premier temps au tri des déchets valorisables (cartons, plastiques, petites ferrailles) puis envoient au compacteur ce qui ne peut pas être traité à l’instar des produits frais, entre autres. Ce sont les déchets ultimes.
“Nous nous occupons d’une quinzaine de petites et grandes surfaces sur toute l’île. Nous collectons tous leurs déchets : ceux qu’ils ont triés au préalable, nous les apportons aux centres de tri agréés. Pour le reste, nous les transportons jusqu’aux centres de stockage des déchets ultimes situés à la Rivière Saint-Étienne et à Sainte-Suzanne”, explique Carole Bachot, responsable du service commercial à la Star.
Avant l’avènement du tri sélectif, les déchets, quelle que soit leur nature, étaient amenés aux différents centres de tri. Conducteur d’engin dans l’un d’entre eux, Jean-Pierre*, 30 ans, a débuté sa carrière en travaillant pendant trois ans dans la chaîne de tri. Avec lui, les rejets des grandes surfaces disposaient d’une seconde vie.
“À l’époque, tous les déchets étaient mélangés. Nos conditions de travail étaient vraiment dégueulasses mais bon, en même temps je pouvais récupérer plein de choses même si c’était, évidemment, formellement interdit”.
Père de deux enfants en bas âge à ce moment-là, Jean-Pierre n’a pratiquement rien investi de sa poche dans l’achat de couches-culottes :
“Tellement de paquets à peine abîmés sont passés entre mes mains, je n’ai eu qu’à me servir. Je me suis fait un vrai petit stock. Je me souviens également d’un Noël où j’ai pu faire plaisir à ma fille ainsi qu’à d’autres petites de ma famille : je leur ai, à toutes, offert des poupées jetées par les supermarchés. Les emballages étaient juste un petit peu détériorés”.
Mis à part ces produits récupérés qui lui permettaient d’économiser sur son budget personnel, Jean-Pierre avoue avoir revendu certaines choses, dont lui, n’avait pas forcément besoin. “Je n’avais pas de chien mais il n’empêche que je conservais ces gros sacs de croquettes. Je les vendais à des prix imbattables. Mes copains étaient ravis”, lance-t-il en souriant.
Le trentenaire n’était pas le seul à “se fournir” au centre de tri : nombre de ses collègues s’étaient également lancés dans l’aventure de la récupération et de la revente des invendus des grandes surfaces à ce moment-là.
“C’était super parce que nous récupérions tous des choses différentes. Il nous arrivait de nous échanger des trucs mais la plupart du temps, on se les revendait entre nous. C’était plus intéressant. Chacun voulait pouvoir tirer son épingle du jeu. On ne gagnait pas des fortunes mais cela nous permettait de mettre du beurre dans les épinards”, admet-il.
Aujourd’hui, la société dans laquelle il travaille s’est spécialisée et ne traite plus les déchets industriels banals (DIB). “On ne peut plus rien récupérer maintenant. C’est dommage. Mais il y a toujours énormément de gaspillage et c’est réellement scandaleux de voir ça. C’est pour cela que nous n’avons pas hésité à nous servir”.
S’ils sont retirés des rayons pour diverses raisons, les invendus des grandes surfaces, fort heureusement, ne finissent pas toujours dans les déchetteries et dans les centres d’enfouissements :
“On ne peut pas prendre de risques en ce qui concerne les produits frais. On est obligé de respecter la législation (cf. repères) mais nous faisons quand même pas mal de dons aux associations qui en font la demande. Il s’agit surtout de produits ayant de petits défauts et que nous ne pourrions pas vendre comme les barils de lessive percés, les boîtes de conserves cabossées …Cela nous permet aussi de réduire les coûts de décharge”, souligne Eric Dany.
Une pratique où tout le monde semble y gagner mais qui, au final, reste très peu répandue dans l’île. Dans un hypermarché, les choses sont claires : les dons aux associations restent très marginaux.
“Nous ne le faisons que lorsque nous sommes sollicités. La décision définitive revient au directeur du magasin. Il donne son accord en fonction de la cause et si nous offrons des marchandises, celles-ci sont toujours prélevées sur le stock. Nous ne proposons pas d’invendus”, souligne un responsable de rayons avant d’avouer sans ambages :
“De toute façon, c’est très rare que cela arrive car ce n’est pas dans notre intérêt de donner. Nous n’avons rien à y gagner donc nous préférons jeter les invendus. Et puis, dans les associations ou les boutiques de solidarité, il y a trop de dérives”.
Une idée reçue qui scandalise Elise Rangoulaman, présidente de l’épicerie sociale Soubic : “Notre travail consiste à aider les personnes ayant des problèmes financiers et qui se retrouvent en situation de précarité. Comment peuvent-ils porter un tel jugement sur ce que l’on fait au quotidien ? Ils ne savent vraiment pas ce qu’ils disent !”, s’insurge-t-elle.
La présidente de cette association basée sur Saint-Denis déplore que la plupart des supermarchés ne soient pas de grands philanthropes. “Malgré nos nombreuses demandes, ce que nous recevons de leur part est assez dérisoire comparé à nos besoins réels.”
Basée à Saint-Paul, l’association “Agir contre l’exclusion” aide depuis 12 ans maintenant les sans-abri, les mal-logés ainsi que des familles nécessiteuses. Au sein de leur structure, ils distribuent près de 60 repas par jour. Selon la trésorière, Yvette Maesen, les dons perçus proviennent surtout des bazardiers du marché forain qui fournissent généreusement légumes ou viandes.
“En ce qui concerne les grandes surfaces, il y a deux ans, le Super U de Saint-Paul nous a contactés. Ils souhaitaient nous donner des yaourts qui allaient périmer dans les trois jours. Nous avons accepté. Depuis, chaque semaine, les repas de nos accueillis sont accompagnés de yaourts comme dessert”.
L’initiative généreuse ne présente pas vraiment de risque puisque entre les dates limites de vente et celle de consommation, il existe un laps de temps dont profitent les plus démunis.
Entre les supermarchés qui n’ont pas du tout souhaité s’exprimer et ceux qui ont usé de la langue de bois, difficile d’obtenir des précisions quant au tonnage exact des produits finissant au fond de la benne. Les seuls chiffres obtenus sont vagues et communiqués par une société de collecte des déchets (voir repères).
Les professionnels de la grande distribution ayant préféré éluder soigneusement la question. Philippe Salmon, directeur technique à la Star est perplexe : “Ils nous payent à la tonne, ils doivent avoir les chiffres, c’est logique”.
Pourquoi faire preuve alors d’autant de mystère ? Y aurait-il des enjeux financiers à la clef ?
Quoi qu’il en soit, une solution efficace pour résoudre au moins la gestion des déchets des grandes surfaces se fait urgente : des études menées par l’Adème en 2006 montrent que le centre d’enfouissement de la Rivière Saint-Étienne arrivera à saturation en…2012
Textes : Mélodie Nourry Photos : Richel Ponapin
(*Prénom d’emprunt)
 La benne aux trésors - Parce qu’ils sont souvent encore propres à la consommation, les invendus alimentaires jetés sont l’objet de convoitises. Certaines personnes n’hésitent pas à soulever le couvercle de “la benne aux trésors”.
La benne aux trésors - Parce qu’ils sont souvent encore propres à la consommation, les invendus alimentaires jetés sont l’objet de convoitises. Certaines personnes n’hésitent pas à soulever le couvercle de “la benne aux trésors”.
Superviseur des magasins Dia à la Réunion, Eric Dany se souvient : “Il y a des gens qui attendaient la fermeture de certains de nos magasins pour aller fouiller nos poubelles et récupérer ce qui leur semblait encore valable. Depuis, nous avons mis en place une nouvelle procédure : nous javellisons tout ce que nous jetons. Dans certains de nos magasins, les bennes sont enfermées dans les réserves. On se dégage de toutes responsabilités en cas d’intoxication alimentaire”.
Cette pratique, très répandue en métropole et aux États-Unis, s’appelle le freegan (de free : gratuit et de vegan : végétalien). Elle consiste pour ses adeptes, à récupérer dans les poubelles, tout ce dont les grandes surfaces se sont débarrassées et qui n’a pas encore été broyé ou compacté.
Selon la loi, tout ce qui est déposé dans une poubelle n’a plus de propriétaire.
- Quid de la restauration rapide ?
Au Mac Do de l’avenue de la Victoire, on donne aussi vite à manger que l’on répond aux questions des journalistes. Au sujet de leurs invendus, un responsable répond sèchement : “Il ne nous reste jamais rien sur les bras, tout est vendu chaque jour”.
Devant notre insistance, l’homme s’impatiente et parvient à lâcher : “S’il nous reste des sandwichs ou autres, c’est jeté. En fait, on s’en tient à la charte mise en place par notre société et qui est valable dans tous nos restaurants à travers le monde : tout ce qui n’est pas parti au bout de dix minutes est automatiquement mis à la poubelle. C’est comme ça, on ne cherche pas à savoir pourquoi.”
Devant un tel gaspillage, certains employés n’hésitent pas à s’affranchir des règlements. Christophe, 33 ans, raconte :
« Mon meilleur ami travaillait dans un de ces restaurants. Chaque fois qu’il devait faire la fermeture, il m’appelait quelques minutes avant afin que je l’attende sur le parking situé à l’arrière du restaurant. Là, il me donnait des sachets remplis de hamburgers. Il n’y en avait tellement que même à plusieurs, on n’arrivait pas à tout finir. Comme on ne pouvait pas se résoudre à les jeter, on donnait ce qu’il restait à des SDF que l’on croisait au hasard dans la rue. »
http://www.clicanoo.com/index.php?id_article=181444&page=article